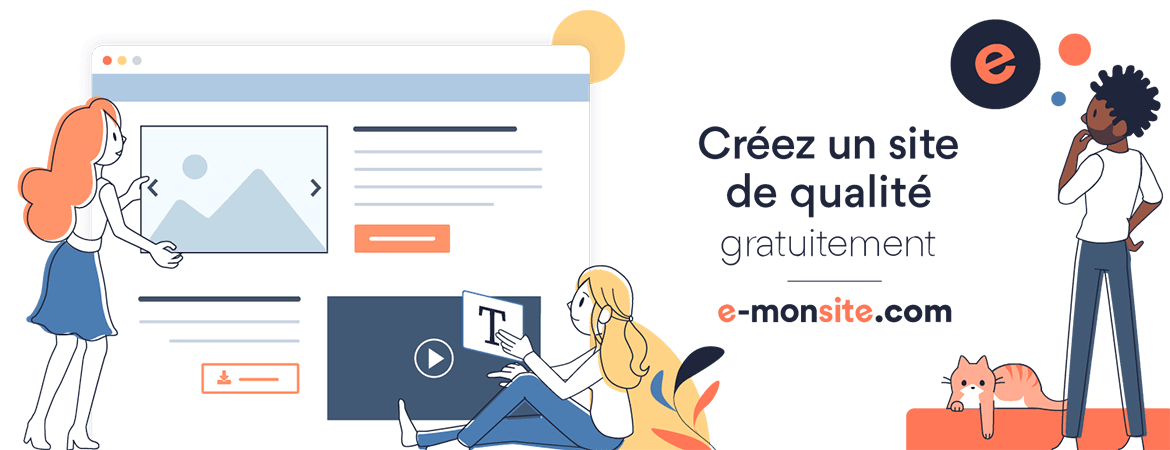Le Bey d'Oran (2ème partie)
 Notre ami Lotfi a eu la gentillesse de me faire parvenir la deuxième partie du "Bey d'Oran", fruit de sa recherche documentaire, que je mets avec grand plaisir à la disposition des lecteurs et visiteurs de pedagotec en leur souhaitant bonne lecture.
Notre ami Lotfi a eu la gentillesse de me faire parvenir la deuxième partie du "Bey d'Oran", fruit de sa recherche documentaire, que je mets avec grand plaisir à la disposition des lecteurs et visiteurs de pedagotec en leur souhaitant bonne lecture.
MOHAMMED EL KEBIR.
(2ème partie)
Sous le règne de Moulai Mohammed, un de ses fi ls nommé Mou-
lai A’bd er-rahman, ayant à se plaindre de son père, vint demander asile
au Bey de Mascara qui l’accueillit avec tous les honneurs dus à son
rang.
Plus tard, en 1201 (1786), Moulai Yazid, frère du précédent, passa
a Mascara pour se rendre en pèlerinage à la Mecque ; le Bey traita ma-
gnifi quement le futur empereur du Maroc, mit à sa disposition le palais
du Bestan (jardin), et exerça envers lui une hospitalité splendide.
A la mort de Moulai Mohammed, Moulai Yezid, son successeur,
exerça contre toutes les créatures de son père des rigueurs inouïes : il
en fi t périr un grand nombre, d’autres cherchèrent à se soustraire par la
fuite à sa fureur. Parmi ces derniers était un de ses proches nommé Ben-
Khadda. Ce personnage trouva également à Mascara non-seulement
un refuge, mais encore toutes les commodités d’une grande existence,
somptueux logement, provisions de bouche de toute sorte, esclaves des
deux sexes, enfi n tout le confortable qu’il pouvait désirer.
Un Khalifa du Bey de Titeri, ayant eu des démêlés avec son maî-
tre, eut aussi recours à Mohammed qui l’accueillit, et lui donna un com-
mandement dans la province
Un fi ls d’un Dey de Constantine avait été forcé par des circons-
tances malheureuses de fuir à la hâte de son pays. Ce personnage no-
miné H’assan Pacha se réfugia à Tlemcen ; le Bey Mohammed subvint
largement à tous ses besoins, et plus tard il intercéda avec succès auprès
du Dey pour que sa famille eût l’autorisation d’aller le rejoindre.
Il me reste maintenant à parler de la lutte que le Bey Mohammed
engagea coutre les Espagnols d’Oran. Son heureuse étoile lui réservait
l’honneur insigne, aux yeux des Musulmans, de contribuer puissamment
à la reddition de cette place. Si, dans ces circonstances, le Bey dut la
majeure partie de son triomphe aux événements extérieurs, c’est-à-dire
à l’ébranlement général occasionné en Europe par la révolution de 89
et qui força l’Espagne à négliger ses affaires d’Afrique pour concentrer
chez elle toutes ses forces, je vois encore ici un éclatant témoignage de
la constante faveur de la fortune à l’égard du Bey.
Avant de commencer le récit des divers accidents de la campa-
gne d’Oran, je ne crois point hors de propos de consigner ici quelques
renseignements qui se rattachent à l’histoire de cette ville, Je me suis
promis de faire entrer dans mon cadre des détails peu connus encore sur
les choses et les hommes d’un pays que nous possédons aujourd’hui.
Ibn Khalican fi xe l’orthographe du nom d’Oran (Ouahran) ; il
s’écrit, dit-il, avec unfath’a sur le ouaou, un soukoun sur le ha, puis un
ra marqué d’unfath’a et suivi d’un élif et d’un noun. C’est, ajoute-t-il
une grande ville du Mar’reb mitoyen qui a produit un grand nombre de
savants.
Es’ S’afdi fi xe l’époque de sa fondation en l’année 290 (902).
On lit dans le commentaire de la Qasida d’El H’alfdoui : « Oran fut
fondée par les rois des Mar’âoua. » L’islamisme y fut fl orissant jusqu’en
l’année 914 ou 915 (1508-9). A cette époque, les Espagnols l’enlevèrent
à Guelmous, un des derniers rois de la. dynastie des Abd el Ouad. On
lit dans. Ibn Khaldoun : « Mohammed ben Abi Aoun et Mohammed ben
Abdoun, arabes de la péninsule Ibérique du temps de la dynastie Om-
miade d’Espagne, vinrent s’établir à Oran et y exercèrent pendant sept
ans l’autorité du consentement des Beni Mesguen pour le compte des
khalifes d’Espagne. Lorsqu’Obeid Allah el Mahdi fonda la dynastie des
Chii’tes en Afrique, il s’empara de Tahart et y établit comme gouverneur
Douâs ben Soulât el Katami. Ensuite, il excita les Berbères contre Oran.
Ceux-ci s’entendirent avec les Beni Mesguen, prirent Oran en l’année
297 (909) et lé livrèrent aux fl ammes. Mohammed ben Abi Aoun prit la
fuite et se réfugia auprès de Douâs qui le rétablit bientôt dans son gou-
vernement après avoir relevé la ville de ses ruines.
La version d’El Bekri diffère en certains points de la précédente.
Selon lui (d’après la traduction de M. Quatremère), Oran fut fondé par
Mohammed ben Abi Aoun et Mohammed ben A’bdoun, négociants ara-
bes de la péninsule Ibérique qui fréquentaient Mers el Kebir. D’après un
contrat conclu entre les Nefza et les Beni Mesguen qui faisaient partie
des Azdadja, ces navigateurs s’y établirent en 290 de l’hégire et y rési-
dèrent jusqu’en 297. A cette époque, les Berbères vinrent attaquer Oran
pour venger un meurtre commis par les Beni Mesguen, ils coupèrent
l’eau qui alimentait la ville et poussèrent vivement le siège. Les Beni
Mesguen s’échappèrent de nuit et se réfugièrent chez les Azdadja. Oran
fut pris et détruit l’année suivante, au mois de cha’bân 298. Abou
H’amid Douas ou, suivant d’autres Djoud ben Moulab (?), rebâtit la
ville et y rétablit Mohammed ben A’oun. El Bekri ajoute qu’en l’anne
343 (954), le 16 du mois de djoumada, Yidi (?) ben Mohammed, de la
tribu des Jafzoun, attaqua lesAzdadja sur une montagne appelée Guider
(l’orthographe est incertaine), les mit en déroute, prit et brûla Oran et en
transporta la population. A cette époque, il y avait tout près d’Oran un
village dont les habitants étaient d’une taille prodigieuse.
Du temps des rois Lemtouniens, connus sous le nom d’Almoravi-
des, il existait, sur une hauteur en face d’Oran, un de ces établissements
à la fois religieux et militaires nommes Ribath. Ce couvent occupait une
position qu’on appelait alors Solb el Kelb (le Roc du Chien) et qui est
restée célèbre pas la mort du dernier des Almoravides, Tachfi n ben Mi
ben Youssef ben Tachfi n, le Lemtounien. Voici ce qu’on raconte de la
catastrophe qui lui coûta la vie.
Ali avait envoyé son fi ls Tachfi n avec une armée pour s’opposer
aux progrès si rapides da fondateur de la dynastie des Almohades, le
fameux Abd et Moumen. Tandis que ce prince tâchait d’accomplir la
mission à lui confi ée par son père, Ali vint à mourir. Tachfi n comprit
alors que rien ne pouvait plus s’opposer au triomphe du rival de sa
maison et que c’en était fait de la puissance des Almoravides. Il prit le
parti de se retirer à Oran. S’il était forcé dans ce dernier refuge, il espé-
rait pouvoir passer de là en Andalousie. Le 27 du mois de Ramadhân
de l’année 589 (1144), Tachfi n sortit d’Oran et gravit le Solb el Kelb
pour aller assister dans le Ribath aux lectures solennelles du Coran et
aux exercices religieux pratiqués pendant ce mois vénéré. Or, Abd el
Moumen avait déjà envoyé contre Oran une division de son armée, et,
depuis le 16, les troupes qui la composaient étaient arrivées devant la
ville. Lorsque l’on apprit au camp que Tachfi n s’était ainsi aventuré
loin des siens, une attaque fut immédiatement tentée contre le Ribath.
Bientôt la porte du couvent fut incendiée. Tachfi n, pressé par le danger,
s’élance à cheval et se précipite à travers les fl ammes. Il s’échappe ;
mais le coursier, trop vivement pressé par l’éperon, s’emporte et, dans
sa course furieuse, il n’obéit plus au frein qui veut le retenir. Bientôt
Tachfi n est précipité dans un ravin et trouve la mort au fond de l’abîme.
Pendant ce temps-là, le Ribath était pris et saccagé et tous ceux qui s’y
trouvaient passés au fi l de l’épée avant que la garnison d’Oran pût être
informée de ce qui se passait.
A la nouvelle de cet événement, Abd el Moumen accourut à Oran
et changea le nom de Solb el Kelb en celui de Solb el Fath’ (Roc de la
Victoire).
Les auteurs arabes s’accordent à dire qu’Oran a produit un grand
nombre de personnages illustres par leur sainteté et leur savoir. Je cite-
rai les plus en renom.
Ibn Khalican, dans son ouvrage biographique, mentionne à l’ar-
ticle Mohammed, le Sid Abou Abd Allah Mohammed et Ouahrani, sur-
nommé Rokn Eddin (la pierre angulaire de la religion). Ce personnage
se rendit en Égypte, du temps du sultan Saladin, fi ls d’Aïoub. Ce prince
l’investit des fonctions de Khatib dans la banlieue de Damas. Il exerça
ces fonctions pendant longues années et sa réputation fut grande dans le
pays. Il mourut en l’année 557 (1161).
On lit dans l’ouvrage d’Abou Abbas el R’obrini intitulé Anouan
ed Berâia (le spécimen de la science) qui traite des savants de Bougie :
«Au nombre des savants qui ont illustré Bougie, on compte le cheikh,
le pieux, le juste, le moral, le jurisconsulte éminent Abou Temim. Il vint
d’Oran se fi xera Bougie où il se livra à l’enseignement de la morale et
de la religion.
Ibn Bechkoural, dans son livre sur les personnages de l’Andalou-
sie, cite le cheikhAbd er-Rahmân ben Abd Allah ben Khaled el Hamdâ-
ni qui était oranais. Son prénom était Abou ‘l Cassem, on l’appelait
communément Ben et Kharvaz, (le fi ls du ravaudeur). Il fut célèbre par
sa sainteté et son détachement des choses du monde. Il lui arriva, à Bag-
dad, une aventure qu’il a ainsi racontée lui-même : « Une vieille femme
m’accosta, et, après avoir jeté un regard presque de compassion sur mes
vêtements râpés, par Dieu ! me dit-elle, vous allez m’apprendre d’où
vous êtes? Lorsque, je lui eus répondu que j’étais du Mor’reb, elle fi t un
geste d’étonnement et ajouta : Quel est donc le motif qui vous amène ici
de si loin ? — C’est, répondis-je, le désir d’acquérir la science. — Vrai-
ment ! reprit-elle, c’est là le seul motif ? — Une seconde affi rmation de
ma part fi nit par la convaincre. Alors, la vieille femme étendant à terre
un manteau qu’elle portait sous le bras, « Puisqu’il en est ainsi, ô mon
fi ls ! s’écria-t-elle, je t’en supplie, foule un moment ce manteau sous tes
pas, et secoue sur lui la poussière de tes pieds ; je le garderai ainsi dé-
sormais pour qu’il soit mon linceul à ma dernière heure. Si un si noble
désir t’a fait venir en Orient de l’extrémité du couchant, tu es véritable-
ment du nombre de ces élus à qui le paradis est destiné. Le Prophète
— 458 —
n’a-t-il pas dit de ses demeures :elles sont réservées indubitablement à
ceux dont les pieds sont de venus poudreux dans le sentier de Dieu. »
Les deux plus grandes célébrités d’Oran, sous le rapport de la
sainteté et du savoir sont le ouali (saint) Sidi Mohammed el H’oouâri et
son disciple le ouali Sidi Ibrahim et Tâzi.
Ibn S’a’d, d’après des renseignements donnés par Ibrahim et
Tâzi établit ainsi la généalogie du premier. Il s’appelait Mohammed ben
Omar ben Osman, ben Menia ben Aiâcha ben A’kacha ben Siied en Nâs
ben Amin en Nâs el R’iâri Ma’zâoui, il est généralement connu sous
le nom d’El Hoouâri ; il appartient d’origine à la grande tribu berbère
des Hoouâra, descendants d’Hoouâr, fi ls de Aourir ’ fi ls de Bernes fi ls
de Berber. Une fraction de cette grande tribu s’établit dans le Morreb
du milieu et occupa le pâté montagneux connu sous le nom du Djebel
Hoouâra. Des villes et villages qu’ils habitaient, il ne reste guère que
El Gala’a ed Deba, le Medcher (village cabile) des Metrâta et celui de
Sidi Abou Amrân ech-Cherif nommé le Medcher de Teliouânet
Mohammed el Hoouâri obtint de Dieu, à un degré éminent, les
dons et les vertus qui constituent la sainteté (el oulâîa). II était fervent
dans la prière, rigoureux observateur du jeûne, noble et largement gé-
néreux ; il aimait les hommes pieux, leur prêtait son appui et les envi-
ronnait de son respect ; jamais il ne franchit les limites établies par la
loi du Prophète ; il se montra toujours continent et détaché des choses
mondaines ; ses actions furent toujours aussi élevées que son savoir, si
éminent. A l’âge de dix ans, il savait déjà par cœur le Coran et avait ac-
quis par cela, même le titre de H’âfed’. A peine adolescent, il possédait
la sagesse et marchait dans son sentier, dirigé par le guide tout-puis-
sant. Il se rendit à Kelmitou pour y visiter un ouali éminent parmi les
saints de Dieu et obtenir en sa faveur l’intercession de ses prières. Le
ouali appela sur lui les bénédictions divines, afi n qu’il pût être, compté
au nombre de ceux qui marchent dans la droite voie. Après s’être sé-
paré du saint vieillard, Mohammed el Hoouâri parcourut les contrées à
l’Est et à l’Ouest ; il s’enfonça dans les déserts, au sein des lointaines
solitudes: Il se nourrissait des plantes et des racines de la terre et du
feuillage des arbres et vivait au milieu des animaux féroces, qui ne lui
faisaient aucun mal.
Un an après qu’il eut atteint le terme de l’adolescence, il se ren-
dit à Bougie pour s’instruire dans la science. Il étudia sous les savants
professeurs de cette ville, tels que le cheikh Sidi Abd er Rahman el
— 459 —-
Oar’lisi et Sidi Ahmed ben Idris. C’est là qu’il orna sa mémoire de plu-
sieurs chapitres de l’ouvrage intitulé El Medouana et Berâdaiia. Quand
il en fut au chapitre Bab es S’yd (chapitre de la chasse), il partit pour
Fez. C’était en l’année 776 de l’hégire (1374), et il avait alors 25 ans. A
Fez, il termina l’étude de cet ouvrage et ouvrit, pour les thâleb, un cours
dans lequel il enseigna le Coran, la jurisprudence et la langue arabe ; et
ses disciples se disaient entre eux qu’ils n’avaient jamais entendu une
diction comparable à la sienne. Il quitta Fez pour accomplir son pèleri-
nage à la Mecque et à Médine ; ensuite il visita Jérusalem et put ainsi se
prosterner dans les trois mosquées les plus vénérées de l’islamisme, où
la prière obtient le comble de l’effi cacité.
A son retour du pèlerinage, il alla se fi xer défi nitivement à Oran
et, par son exemple et ses leçons, il tourna vers Dieu les cœurs de là
multitude. Les savants accouraient en foule l’écouter ; il expliquait et
élucidait les questions les pins épineuses ; il semblait lire au fond de la
pensée des hommes ; souvent ses réponses aux propositions qu’on lui
Soumettait étaient complexes et chaque assistant y trouvait la solution
de ce qui l’embarrassait, avant même qu’il eût interrogé.
Les Arabes avaient pour El Hoouâri autant de crainte que de res-
pect. Dieu, disaient-ils, exauçait toujours ses prières et, par suite, son
ressentiment était redouté à l’égal du courroux céleste. On trouve dans
les écrits du temps une foule de récits merveilleux concernant ce per-
sonnage qui prouvent qu’au nombre de ses vertus, ne fi guraient point la
patience et l’oubli des injures.
Un jour, il avait envoyé un de ses serviteurs vers un chef des
Beni A’mer, nommé Osmân, pour l’engager à rendre une somme d’ar-
gent injustement ravie à l’un de ses compagnons. Le chef des Beni
A’mer accabla le messager de paroles outrageantes et le fi t mettre en
prison. A la nouvelle de ce traitement, El Hoouâri fut pris d’une colère
si vive que son visage en devint tout noir. Il se retira seul à l’écart et
on l’entendit murmurer à plusieurs reprises le mot arabe neferthekh ;
qui se dit d’une chose qui se fracasse en tombant. Or, il arriva que ce
jour là Osman était monté à cheval pour prendre part aux réjouissan-
ces d’une noce. Tout-à-coup, les spectateurs aperçurent un personnage
vêtu de blanc qui saisit Osmân par les pieds et le précipita violemment
contre terre. On accourut à lui et on le trouva merfethekh, comme avait
dit le ouali. Le coup avait été si violent que sa tête s’était enfoncée
dans sa poitrine. La Mère de ce chef, en proie à la plus vive douleur,
— 460 —
fi t à I’instant rendre la liberté au messager d’El Hoouâri, afi n d’apaiser
son courroux.
L’auteur du Djoumani elle encore une histoire aussi étrange dans
laquelle une levrette joue le rôle le plus important. Une femme, dit-il,
avait son fi ls prisonnier en Andalousie ; elle alla trouver El Hoouâri pour
se plaindre de son malheur. L e saint homme lui dit d’apprêter un plat
de bouillon et de viande et de le lui apporter. La femme obéit et revint
bientôt avec l’objet demandé. El Hoouâri avait une levrette qui nourris-
sait alors ses petits, il lui fi t manger le plat apporté, puis, lui adressant la
parole : « Va maintenant, dit-il, en Andalousie et ramène le fi ls de cette
femme. » La levrette partit à l’instant et Dieu permit qu’elle trouvât le
moyen de passer la mer. Arrivée sur la côte andalouse, elle rencontra le
prisonnier qui, ce jour là, était allé au marché acheter de la viande pour
une chrétienne dont il était l’esclave. La levrette, d’un bond, lui arrache
cette viande des mains, prend sa course et se sauve dans la direction
du rivage. Le jeune Arabe se mit à sa poursuite. La levrette franchit un
canal, l’Arabe le franchit après elle ; tous deux arrivent sur le bord de
la mer, tous deux la traversent encore, par la toute puissance de Dieu, et
(1)
rentrent à Oran sains et sauf .
La crédulité des Arabes accepte pleinement tous ces contes qui
nous font sourire. Tout cela est possible, disent-ils, à tous ceux que Dieu
a gratifi és du don des Kerâmat (miracle qui n’exige rien en dehors des
forces de la nature). Ils sont aussi persuadés que c’est à la malédic-
tion d’El Hoouâri qu’est due la longue possession d’Oran par les Espa-
gnols.
L’auteur de l’Hizeb et A’ârifi n dit, en propres termes, que le
cheikh El Haouâri vendit Oran aux infi dèles, en appelant la vengeance
de Dieu contre les habitants de cette ville qui lui avaient tué son fi ls. Un
ouali nommé Sidi A’li el As’r’ar dont le tombeau est en face de celui
qui renferme le corps de Sidi ed Daoudi ben Nas’r, fut le témoin de la
malédiction de ce père irrité. Il demanda à Pieu qu’Oran devînt pendant
trois cents ans la proie des chrétiens. Il est vrai que la durée des deux
occupations d’Oran par les Espagnols ne comporte point un tel nombre
d’années. A cela, les Musulmans répondent que les années en moins ont
pu être rachetées par la piété et les bonnes œuvres.
_________________________________________________________________
(1) On applique à Alger une légende toute semblable à Sidi Mansour dont la
Koubba se trouvait autrefois entre les deux anciennes portes de Bab Azzoun. — N.
de la R.
— 461 —
El Hoouâri mourut en l’année de l’hégire 843 (1439), le samedi,
deuxième jour du mois de rebia’ et tsâni ; il était, âgé de 92 ans. Oran
possède son tombeau, ce ouali laissa en mourant un fi ls du nom d’Abd
er Rahman ben H’amêd, qui fut le père d’une nombreuse descendance,
suivant le commentateur de l’H’alfâouiia. Cette postérité fut de tout
temps fort respectée des populations qui auraient craint en l’offensant
d’encourir la vengeance de l’irascible Ouali.
Observons en passant que la mort d’El Hoouâri eut lieu 71 ans
avant l’arrivée des Espagnols à Oran et qu’ainsi, sa rancunière prière
demeura bien longtemps sans être exaucée.
Cet ouali si célèbre eut pour successeur de son savoir et de son
autorité à Oran son disciple chéri Sidi Ibrahim et Tazi dont j’emprunte
aussi la biographie au Djoumani.
Ibrahim était de la tribu berbère des Beni Lent qui habitaient Taza.
C’est dans cette ville qu’il naquit et passa son enfance. De là, lui vient
son surnom d’El Tazi. Il marcha dès son jeune âge dans le sentier de la
sagesse. Il ne tarda point à accomplir le pèlerinage. Dieu lui fi t trouver
partout dans son voyage un accueil des plus bienveillants et le mit en
rapport avec les ouali des contrées qu’il visita. Il put converser avec
un grand nombre d’entre eux et acquérir, en écoutant leurs leçons, la
possession de la science et pénétrer les secrets des connaissances dites
occultes pour le vulgaire.
C’est au retour du Hédjaz que, tout entier au souvenir de l’amitié;
il composa cette qasyda émouvante qui commence ainsi :
« Je vois fuir et disparaître les jours et les années et le temps, si
lent au gré de mes désirs, ne peut me réunir: enfi n à l’ami que j’aime, à
celui que Dieu a si libéralement doté dans tout son être. Ah ! la patience
est impossible pour qui est séparé de tant de perfections. Quand pour-
rai-je l’étreindre d’un embrassement qui guérisse, mon cœur. Quand
donc ce temps avare de faveurs, me réunira-t-il à lui. »
Après son pèlerinage, Ibrahim se rendit à Tunis et les savants de
cette ville lui délivrèrent les diplômes qui témoignaient de son savoir ;
il alla ensuite à Tlemsen. Là, il profi ta encore des leçons d’Ibn Merzoug
et un nouveau diplôme vint s’ajouter à tous les autres. Enfi n, il se trans-
porta à Oran, attiré par le désir de visiter El Hoouâri. Son dessein était
alors de retourner aux deux villes saintes ; mais le ouali l’en détourna,
et le pria de ne plus se séparer de lui. Il avait reconnu en lui un vaste
savoir et il le destinait à le remplacer. Il avait pour lui les plus grands
égards et tant qu’il vécut il exhorta son entourage à se former d’après
l’exemple d’Ibrahim et à lui prodiguer la vénération et le respect.
A la mort d ’El Hoouâri, Ibrahim le remplaça. Il avait encore
agrandi sous son dernier maître le cercle de ses connaissances el nul
ne put lui disputer le premier rang. A son instruction profonde, il joi-
gnait une grande élévation de caractère et une remarquable distinction.
Il était éminent jurisconsulte et son esprit était imbu des doctrines du
Soufi sme. Entre toutes ses qualités, on remarquait la libéralité, la ré-
signation et la patience. Il aimait les grands et supportait patiemment
leur caractères Oran brilla par lui d’un vif éclat. Sa population s’accrut
rapidement d’un nombre extraordinaire d’étrangers qu’attirait la répu-
tation d’Ibrahim.
Ibn Sa’ad, renchérissant sur tous ces éloges, dit de lui : « lbrahim
fi t d’Oran une sorte de marché de la réputation et de la gloire ; il dé-
ploya dans cette ville les bannières de l’Islam et de la foi : il y organisa
des solennités religieuses, appela les hommes à l’étude des choses hu-
maines et divines et les fi xa dans le pays de la science, loin de laquelle
ils erraient avant lui. »
Ibrahim fi t construire une Zaouïa célèbre, tant par la réputation
du fondateur que par l’importance de l’édifi ce, qui renfermait dans son
enceinte des chapelles (mesdjed), des jardins, des medersa, des appar-
tements destinés aux étrangers qui venaient le visiter ; des bains, des
réservoirs d’eau, des bibliothèques, des magasins d’armes, etc., etc. Cet
établissement n’eut point son pareil dans toute l’étendue du Mor’reb du
milieu.
Avant Et Tazi, l’eau manquait à Oran ; on avait souvent pensé à
remédier à cet inconvénient, mais la bonne volonté ou les ressources
suffi santes avaient jusque-là fait défaut. Ibrahim fi t, à ses frais, exécuter
de grands travaux dans les environs de la ville et, grâce a son activité et
à ses dépenses, il parvint à faire arriver dans son enceinte l’eau de sour-
ces assez éloignées. L’auteur du Djoumani réfute l’opinion de ceux qui
prétendent que ces sources furent trouvées dans le terrain compris entre
les forts et il cite à ce sujet un vers d’une qasyda en idiome vulgaire
composée par, un certain Sidi Za’im dont le tombeau est à Maza’ran,
(Mazagran) Dans ce vers il est dit :
« Ibrahim et Tazi choisit Oran pour séjour : c’est lui qui réunit à
Ras el. A’ioun l’eau des sources depuis Ifry jusqu’à El H’ora ? »
On attribua à Ibrahim plusieurs antres constructions de moin-
dre importance toutes fondées de son argent et toutes léguées comme
H’abous aux divers établissements pieux. Je ne trouve nulle part men-
tion de la fortune personnelle de ce ouali. Il est donc probable que les
revenus de sa profession, que soit à-le reconnaissance de ses nombreux
élèves, soit aux dons offerts par les fi dèles étaient fort considérables.
Il sut toutefois en faire un bien noble usage et c’est le cas de dire
avec un poète arabe :
« Les traces qu’il a laissées apprennent ce qu’il fut et la pensée se
le fi gure aussi bien que si l’œil l’avait vu. »
Dévoué tout entier à la chose publique, il dépensa sans compter et
sans rien garder pour l’avenir, aussi son fi ls m’hérita pas de lui, même
une « rognure d’ongle,», suivant l’énergique expression de l’auteur qui
nous instruit de sa vie. Souvent, ses amis lui, reprochaient ses prodi-
galités, sa générosité sans limite qui amenaient la pauvreté dans sa de-
meure ; il se contentait alors de leur réciter ces vers d’Abou ‘l ‘Abbas
ben el A’rif :
« On me reproche d’être généreux, mais la libéralité est dans
mon caractère et je ne puis prétendre changer ce que la nature a formé.
D’ailleurs, je ne vois rien de comparable à la générosité. Récente, elle
charme; ancienne, elle fait encore la joie des souvenirs. Celui qui n’a
pas vécu de sa vie n’a rien connu de beau dans ses jours. Laissez-moi
donc être libéral à mon aise, l’avarice est un opprobre. Quel mal me fait
d’être appelé prodigue ; l’homme libéral a tout le monde pour famille,
celui dont la main se ferme toujours n’a ni parents, ni amis. Pourquoi re-
douter la pauvreté, pourquoi établir un rempart autour de ses richesses.
Soyons généreux ; la générosité n’est-elle pas un attribut de Dieu. »
Et Tazi mourut à Oran, le 9 dimanche, 3 de cha’bân, en l’année
866 (1461). Les Arabes prétendent qu’il est enterré à El Galla’a.
GORGOUS
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021
Ajouter un commentaire